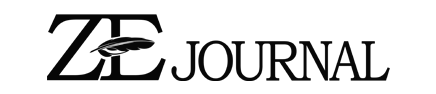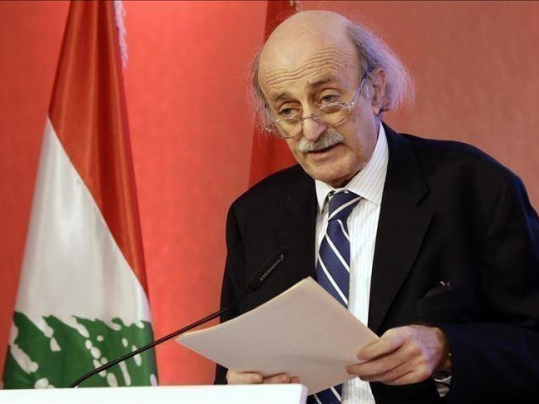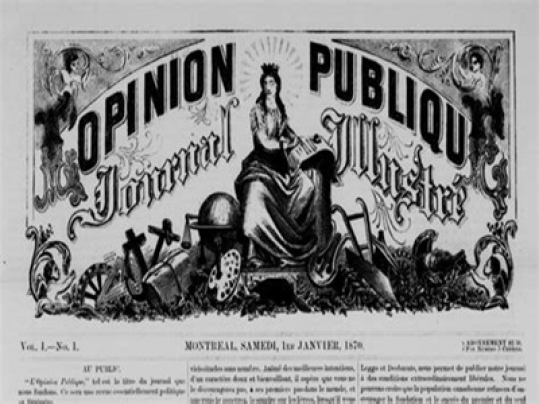Le Liban, en sursis entre pressions étrangères, fractures internes et désespoir populaire… Et la Résistance, dernier rempart

Le Liban est à nouveau plongé dans une crise profonde. La récente décision du gouvernement d’approuver une feuille de route en vue du désarmement de la Résistance a agi comme un révélateur brutal : elle a mis en lumière les contradictions d’un État qui peine à exercer sa souveraineté, tiraillé entre pressions internationales, équilibres communautaires internes et une population désabusée.
Cette mesure, aussitôt rejetée par le Hezbollah et Amal, a été dénoncée comme illégale et dangereuse. Pour ses opposants, elle ne menace pas seulement l’équilibre national fragile, mais elle risque de précipiter le pays dans un cycle de tensions incontrôlables.
Au Sud, la colère gronde. Les habitants, déjà meurtris par des décennies de guerre, paient un prix exorbitant : en l’espace de quelques jours, plus de cent violations israéliennes du cessez-le-feu ont été enregistrées et douze civils ont été tués. Les bombardements frappent maisons, champs, infrastructures. Et partout, la même conviction revient : sans la Résistance, il serait impossible de tenir face à ces agressions répétées.
À Beyrouth, les autorités s’agitent. Le président Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam multiplient les consultations d’urgence, dépêchant leurs émissaires auprès du Hezbollah et de Nabih Berri afin de calmer les tensions. Dans les chancelleries, les discussions s’enchaînent entre Washington, Tel-Aviv et les représentants libanais. Mais les narratifs contradictoires, les promesses ambiguës et les discours de façade nourrissent une méfiance généralisée.
Car derrière cet épisode se joue une réalité plus large : le Liban est confronté à une crise systémique. Politique, institutionnelle, économique et sociale, elle enferme le pays dans une impasse chronique, sans perspective claire de sortie.
Le choc d’une décision : un gouvernement pris en étau
Lorsque le gouvernement libanais a annoncé l’approbation d’une feuille de route pour le désarmement de la Résistance, la réaction fut immédiate. Le tandem Hezbollah-Amal a qualifié la décision de «nulle et non avenue», dénonçant son caractère anticonstitutionnel. Pour ces forces, il ne s’agit pas d’un simple désaccord politique : c’est une atteinte directe à l’équilibre national, une remise en cause de la stabilité du pays.
Dans un Liban où chaque décision d’envergure exige un consensus communautaire, cet acte unilatéral a été vécu comme une provocation. Il a déclenché non seulement la colère des acteurs politiques concernés, mais aussi celle d’une population déjà fragilisée.
Une classe politique en équilibre précaire
Pris dans la tourmente, le président Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam ont rapidement tenté d’éteindre l’incendie. Leur conseiller militaire, le général André Rahal, a été dépêché auprès du Hezbollah puis chez Nabih Berri. Leur message, répété à plusieurs reprises : «Le Liban n’a aucune intention de provoquer un conflit interne, ni d’opposer l’armée à une partie de son peuple».
Le Premier ministre a même ajouté que la décision «n’oblige pas le Liban» à prendre des mesures exécutives tant qu’Israël n’aura pas respecté ses engagements : retrait progressif des zones occupées, libération des prisonniers, respect strict du cessez-le-feu.
Ce double discours illustre la position inconfortable du gouvernement : d’un côté, afficher une volonté de coopération aux yeux de la communauté internationale ; de l’autre, rassurer les forces internes et éviter une implosion.
Le Liban avance ainsi sur une ligne de crête, oscillant entre pressions extérieures et contradictions internes.
L’armée, loyale mais impuissante
L’armée libanaise reste, aux yeux de nombreux citoyens, la seule institution véritablement nationale. Elle bénéficie d’un respect transcommunautaire rare, dans un pays fragmenté par les appartenances religieuses et politiques. Pour beaucoup, elle incarne une certaine idée de l’unité et de la dignité nationale.
Mais cette image se heurte à une réalité brutale : ses capacités opérationnelles sont limitées.
Le paradoxe d’une armée bridée
Sous-équipée, dépendante des aides étrangères, sans doctrine stratégique claire, l’armée libanaise ne peut pas, à elle seule, assumer la mission de défense nationale face à Israël.
Le commandement militaire a été clair : il ne prendra aucune mesure risquant de provoquer une confrontation interne. Traduction : l’armée n’ira pas s’opposer à la Résistance et sait qu’elle n’en a pas les moyens.
Ce paradoxe est au cœur du malaise : l’armée incarne une souveraineté théorique, mais son incapacité à agir alimente l’image d’un État humilié et impuissant.
Le Sud : colère, humiliations et mémoire des souffrances
Depuis des décennies, le Sud du Liban est la première ligne des agressions israéliennes. Bombardements réguliers, destructions massives, déplacements forcés : les habitants ont appris à vivre avec la guerre comme horizon quotidien.
Les témoignages recueillis ces derniers jours reflètent cette mémoire de souffrance et de résistance :
«L’État ne fait que compter les martyrs», accuse le père d’un jeune tué dans un raid de drone.
«La paix n’est pas la capitulation», affirme un habitant de Bint Jbeil.
«Sans la Résistance, nous ne serions pas ici», répète un autre.
Ces paroles disent tout : pour les habitants du Sud, l’État est absent, voire soumis aux diktats étrangers. La seule protection perçue comme réelle est celle de la Résistance.
Le traumatisme de 2006
La guerre de l’été 2006 a laissé une empreinte indélébile. En un mois, plus de 1000 civils ont été tués, des villages entiers rasés, des infrastructures détruites.
Si le Hezbollah a consolidé sa légitimité populaire à travers cette guerre, l’État central en est ressorti affaibli, incapable d’assurer une reconstruction efficace. Cette mémoire nourrit aujourd’hui une défiance profonde vis-à-vis des autorités de Beyrouth.
Pour beaucoup, 2006 reste le symbole d’un État absent, laissant à la Résistance la charge de protéger, de reconstruire et de maintenir la dignité des habitants.
Manœuvres américano-israéliennes : ambiguïtés et expansionnisme
Dans ce contexte explosif, deux récits circulent et traduisent la complexité des rapports de force régionaux.
D’un côté, le site américain Axios rapporte que Washington aurait demandé à Israël de réduire ses frappes «non urgentes» contre le Liban. L’idée, selon ce récit, serait de créer un climat plus propice à l’application du processus politique engagé par Beyrouth sur la question du désarmement. Ce discours se veut rassurant, laissant entendre que les États-Unis jouent un rôle de médiateur cherchant à éviter une escalade.
De l’autre côté, le député libanais Jamil Sayyed affirme que la réalité est tout autre : Israël aurait exigé le maintien de ses forces dans quatorze villages du Sud, avec l’annexion pure et simple de certains territoires, et l’installation de bases militaires permanentes dans des zones stratégiques. Dans cette version, il ne s’agit pas d’une désescalade, mais bien d’une extension de l’occupation qui viserait à remodeler la carte du Sud-Liban selon les intérêts israéliens.
Ces deux récits opposés alimentent une confusion volontaire : d’un côté, un discours diplomatique de façade destiné à rassurer l’opinion internationale ; de l’autre, une réalité militaire et territoriale qui traduit la persistance d’une logique expansionniste.
Une méfiance nourrie par l’histoire
Les Libanais, confrontés depuis des décennies aux agressions israéliennes, savent à quoi s’en tenir. L’histoire récente a montré que les promesses américaines ou occidentales ne se traduisent jamais par une protection réelle.
En 2024, par exemple, Amos Hochstein, l’émissaire américain, avait assuré que Tel-Aviv n’avait aucune intention d’attaquer massivement le Liban. Quelques mois plus tard, les bombardements israéliens frappaient sans relâche les villages du Sud, réduisant à néant toute crédibilité de ces garanties diplomatiques.
Les déclarations récentes de Benjamin Netanyahou viennent renforcer cette méfiance : lorsqu’il parle de «mission historique» et de sa vision d’un «Grand Israël», il ne fait pas mystère de ses ambitions territoriales. Dans l’esprit de nombreux Libanais, il n’existe donc pas de doute : derrière les discours d’apaisement se cache un projet d’annexion progressive visant à affaiblir durablement le Liban et à empêcher le retour normal de ses populations dans le Sud.
C’est pourquoi l’opinion publique perçoit la version américaine comme un habillage diplomatique, une tentative de maquiller une réalité beaucoup plus brutale : la volonté israélienne d’imposer par la force un nouvel équilibre géopolitique au détriment du Liban.
Une crise multidimensionnelle
La controverse sur le désarmement n’est qu’une partie émergée de l’iceberg. En réalité, le Liban traverse une crise globale, qui touche tous les aspects de la vie publique et menace les fondements mêmes de l’État.
Une économie à l’agonie
Depuis 2019, l’économie libanaise s’est effondrée. La monnaie nationale a perdu plus de 90% de sa valeur, entraînant une flambée vertigineuse des prix. Les banques, autrefois perçues comme solides, sont en faillite. Les dépôts des épargnants sont gelés, réduisant à néant la confiance du citoyen dans le système bancaire.
Cette crise a plongé plus de la moitié de la population dans la pauvreté. Les classes moyennes, pilier de la stabilité sociale, s’effondrent à grande vitesse. Le Liban vit désormais grâce aux transferts de sa diaspora et à l’économie informelle, sans véritable plan de relance.
Une paralysie politique
À cette catastrophe économique s’ajoute une paralysie politique chronique. Le système confessionnel, hérité du Pacte national de 1943 et figé par l’accord de Taëf en 1989, empêche toute réforme structurelle. Chaque communauté détient un droit de veto, transformant le Parlement en arène de blocages permanents.
Les vacances présidentielles se sont multipliées. Les gouvernements successifs tombent sans jamais parvenir à instaurer un consensus durable. Le résultat est un pays sans cap, incapable d’adopter des réformes pourtant vitales.
Un désespoir social grandissant
Les Libanais, et particulièrement les jeunes, quittent massivement le pays. Le phénomène de l’hémorragie migratoire est devenu une plaie ouverte : médecins, ingénieurs, enseignants, étudiants… tous cherchent à reconstruire ailleurs un avenir devenu impossible au Liban.
Les classes populaires, elles, sombrent dans la pauvreté. L’explosion de la colère se traduit par des manifestations sporadiques, mais aussi par un désespoir silencieux, où la survie quotidienne prend le pas sur tout autre projet.
Des institutions en faillite
L’État libanais, déjà affaibli, s’effondre sous le poids de la crise. L’électricité est rationnée, les hôpitaux sont sous-équipés, la justice est paralysée. Les fonctionnaires, mal payés, peinent à assurer leurs missions.
Aux yeux de la population, l’État n’est plus qu’une coquille vide, incapable de protéger ses citoyens, ni de garantir des services publics de base. Beaucoup le perçoivent comme complice des pressions étrangères et prisonnier de ses propres élites corrompues.
Résultat : le Liban apparaît aujourd’hui comme un État failli, où la majorité de la population survit dans des conditions indignes.
La diaspora : pilier vital, spectatrice impuissante
Sans la diaspora, l’économie libanaise se serait déjà effondrée. Ses transferts financiers, évalués à plusieurs milliards de dollars par an, représentent l’une des principales sources de devises pour le pays.
La diaspora libanaise en Afrique joue un rôle central : à Abidjan, Dakar, Lagos ou Kinshasa, les Libanais ont bâti des empires commerciaux qui continuent de financer leurs familles et leurs villages d’origine. Ces apports permettent de soutenir l’éducation, la santé, la reconstruction et de maintenir à flot une économie nationale asphyxiée.
Mais cette diaspora vit un paradoxe cruel. Elle est vitale économiquement, mais exclue politiquement. Ses voix ne pèsent pas dans les décisions stratégiques du pays.
De Dakar à Abidjan, de Lagos à Kinshasa, les Libanais expriment une même frustration : contribuer chaque jour à la survie du pays, mais sans pouvoir influencer ses choix. Pour beaucoup, l’État central reste sourd aux attentes de ses enfants de l’étranger, réduisant leur rôle à celui de simples «pourvoyeurs de fonds».
Une responsabilité nouvelle ?
Face à cette impasse, certains appellent la diaspora à franchir un cap :
Ne plus se contenter de soutenir financièrement.
S’organiser politiquement et diplomatiquement.
Exercer une pression sur les élites libanaises afin qu’elles rompent avec la paralysie confessionnelle.
Utiliser leurs réseaux d’influence en Afrique et ailleurs pour alerter la communauté internationale sur les violations israéliennes et la situation du Liban.
La diaspora pourrait ainsi devenir non seulement un poumon économique, mais aussi une voix stratégique, capable de relayer la cause libanaise sur la scène mondiale.
Un pays suspendu entre humiliation et survie
Le Liban vit une crise existentielle. Pris entre pressions américano-israéliennes, divisions internes, effondrement économique et colère populaire, il semble suspendu entre humiliation et survie.
La Résistance demeure, pour une partie du peuple, le dernier rempart contre l’annexion et la disparition. Mais tant que les causes profondes de cette Résistance – occupation, agressions, humiliations – ne seront pas traitées, toute tentative de désarmement sera perçue comme une provocation.
Quant à la diaspora, elle est appelée à choisir : rester une spectatrice impuissante, ou devenir un acteur politique et diplomatique capable d’accompagner le Liban dans la quête d’un projet national commun.
Sans sursaut collectif, le pays restera ce qu’il est depuis trop longtemps : un État en sursis, oscillant entre la tutelle étrangère et une souveraineté inachevée.
- Source : Al-Manar (LIban)