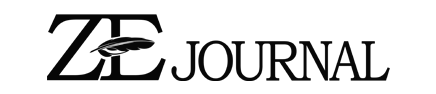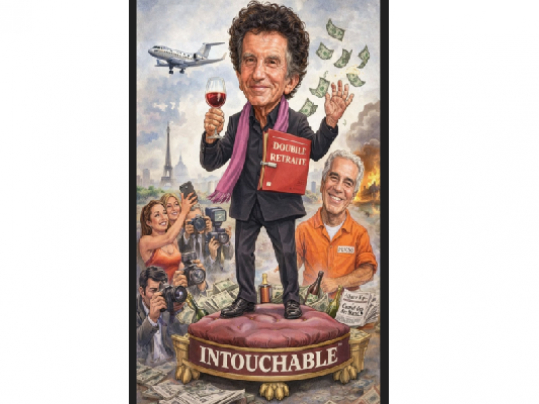Les vieux amis en froid : Trump zappe Netanyahou et redistribue les cartes au Moyen-Orient

Trump est en train de redessiner l’Asie occidentale sans Israël, et Netanyahou n’arrive pas à le joindre au téléphone.
Le président américain Donald Trump est actuellement en visite officielle dans le golfe Persique, et non à Tel-Aviv. Des milliers de milliards sont en jeu, le dossier nucléaire avance et Gaza est au centre d’un accord secret excluant Israël. Pour la première fois depuis des années, la chorégraphie du pouvoir américain en Asie occidentale se déroule sans qu’Israël et son Premier ministre Benjamin Netanyahou n’en soient l’élément central.
Les médias israéliens, notamment Israeli Army Radio, Channel 12 et Israel Hayom, confirment les retombées : Trump a rompu toute communication directe avec le Premier ministre israélien. Un membre haut placé de l’entourage de Trump aurait déclaré au ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, que le pire pour le président est d’être perçu comme naïf ou manipulable, et que c’est exactement ce qu’a fait Netanyahou.
Washington ne perd pas de temps. Un plan pour Gaza est déjà en cours d’élaboration avec Le Caire, Doha et Abu Dhabi, et le Hamas a été appelé au Caire. Comme l’a déclaré sans détour l’envoyé américain Steve Witkoff à la presse israélienne : «Nous voulons ramener les otages, mais c’est Israël qui ne veut pas mettre fin à la guerre». Parallèlement, un accord nucléaire saoudien, autrefois subordonné à la normalisation des relations avec Israël, avance sans l’avis de Netanyahou.
Il ne s’agit pas seulement d’un changement de ton, mais d’une guerre d’ego. Trump tire sa popularité de son rôle exclusif de maître d’œuvre de la politique régionale. À ses yeux, laisser Netanyahou se servir de lui ou tenter de lui dicter son discours est intolérable. Pour «Bibi», c’est une question de survie.
Après s’être maintenu au pouvoir plus souvent que n’importe quel autre dirigeant israélien, souvent malgré la menace d’inculpations, Netanyahou ne se voit pas comme un homme d’État comme les autres, mais comme le dernier rempart contre l’effondrement d’Israël. Pour les deux dirigeants, le contrôle n’est pas seulement une question de pouvoir, mais aussi d’identité.
La rupture entre Kushner et Netanyahou
Il n’y a pas si longtemps, Netanyahou pouvait appeler la Maison-Blanche et obtenir ce qu’il voulait. Trump a transféré l’ambassade américaine à Jérusalem, coupé les fonds de l’UNRWA, retiré les États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien, dévoilé le soi-disant «accord du siècle» et favorisé la normalisation des relations entre les pays arabes et l’État occupant.
Jared Kushner, gendre de Trump et responsable de la politique américaine en Asie occidentale, était plus qu’un simple intermédiaire avec Israël : il entretenait des relations privilégiées avec Netanyahou.
Comme l’ont rapporté les médias israéliens et américains, Netanyahou a déjà passé une nuit chez les Kushner, dans le New Jersey. Jared, alors adolescent, avait cédé sa chambre à Netanyahou. Cette anecdote n’était pas anodine, mais révélatrice. Les Kushner, en particulier le père de Jared, Charles, ont brouillé les frontières entre diplomatie et loyauté familiale.
Lorsque Trump est arrivé au pouvoir, cette proximité s’est traduite en politique. L’AIPAC, la famille Adelson, la ZOA [Zionist Organisation of America] et un réseau de think tanks bellicistes et de méga-donateurs ont défini la stratégie. Les objectifs régionaux de Netanyahou – isoler l’Iran, écarter les Palestiniens et officialiser la normalisation avec les pays arabes – ont été incorporés dans la doctrine de Trump.
Mais des fractures sont apparues. Les responsables israéliens ont discrètement reproché à Kushner d’avoir fait pression en faveur des accords d’Abraham, qui exigeaient qu’Israël suspende l’annexion de la Cisjordanie occupée. Toutefois, la rupture la plus grave s’est produite lorsque Trump a finalement refusé d’autoriser une frappe militaire contre l’Iran, malgré ses discours incendiaires.
Netanyahou, politiquement assiégé «chez lui» et obsédé par Téhéran, estimait l’escalade à la fois nécessaire et politiquement bénéfique. Trump est resté sceptique, préférant préserver son image de négociateur plutôt que celle d’un président belliciste.
L’obsession de Netanyahou pour l’Iran
Peu de dirigeants modernes ont fondé leur identité politique de manière aussi obsessionnelle sur une seule menace. Pour Netanyahou, c’est le programme nucléaire iranien. Entre les caricatures de bombes brandies à l’ONU et les campagnes de pression menées depuis des décennies à Washington, il s’est donné pour mission à vie d’empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire.
Son discours n’a pas changé.
«Nous ferons tout pour empêcher l’Iran de devenir une puissance nucléaire, pas pour les autres, mais pour nous-mêmes», a déclaré le premier ministre israélien en mars 2024. Pendant ce temps, les fuites provenant des services du renseignement israéliens se poursuivent.
Le Jerusalem Post a rapporté en mars que le chef d’état-major de l’armée israélienne récemment nommé, Eyal Zamir, a déclaré que 2025 serait «l’année des guerres» contre Gaza et l’Iran, et que l’armée est prête à tous les scénarios.
Trump, cependant, semble prendre ses distances. Des sources politiques américaines affirment que le limogeage de Mike Waltz, membre du Congrès américain, du cercle de Trump, aurait été provoqué par une réunion secrète entre Waltz et Netanyahou, destiné à synchroniser leur message et pousser Trump à la guerre. Mais Trump s’y est opposé.
Il se pourrait plutôt qu’il se prépare à laisser Israël frapper seul. Ou bien il garde ses distances pour pouvoir clamer qu’il est hors de cause si Netanyahou passe à l’action unilatéralement. Comme l’a dit un jour l’ancien chef du renseignement militaire Amos Yadlin : «Israël n’aura pas besoin des États-Unis le jour J. Il peut se débrouiller seul».
Les escales de Trump dans le Golfe persique sans passer par Jérusalem
Après Riyad, Trump se rendra à Abu Dhabi et à Doha, mais pas à Jérusalem. Son équipe ambitionne de ramener plus d’un billion de dollars d’accords. L’ordre du jour comprend également un cessez-le-feu à Gaza et un plan de reconstruction élaboré en coordination avec l’Égypte, le Qatar et les Émirats arabes unis, sans participation directe d’Israël.
Un responsable américain qui a rencontré les familles des otages à Gaza a déclaré que Trump est «de plus en plus frustré» par le refus d’Israël de mettre fin à la guerre. Comme l’a rapporté Al-Jazeera, ce responsable a ajouté :
«Si Israël ne reprend pas ses esprits, même l’«accord du millénaire» se fera sans lui».
De son côté, Oman a repris son rôle d’intermédiaire discret entre les États-Unis et l’Iran. La diplomatie en coulisses a contribué à un accord de cessez-le-feu bilatéral entre Washington et le gouvernement de Sanaa au Yémen afin de réduire les tensions dans la mer Rouge. «Les États-Unis n’ont pas besoin de l’autorisation d’Israël» pour conclure un accord avec le gouvernement yéménite aligné sur Ansarullah, a déclaré un responsable américain, cité par la presse israélienne.
L’accord nucléaire saoudien, mais sans Israël
Pendant des années, Israël a exigé que tout programme nucléaire saoudien approuvé par les États-Unis soit soumis à Tel-Aviv. Ce veto informel s’inscrivait dans un compromis plus large : la normalisation en échange du droit à l’énergie nucléaire civile, mais ce scénario est en train de voler en éclats.
Selon Israel Hayom et l’Arab Weekly, Trump n’a plus le soutien du Sénat pour faire de la participation israélienne une condition préalable à l’accord avec l’Arabie saoudite. Son équipe élabore actuellement un cadre permettant au royaume d’enrichir de l’uranium sans aucune condition.
L’urgence est réelle. Dans une interview de CBS largement citée en 2018, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane (MbS) a lancé cette mise en garde :
«Si l’Iran développe l’arme nucléaire, nous ferons de même dans les plus brefs délais».
Alors que l’Iran aurait atteint un niveau d’enrichissement de l’uranium proche de celui requis pour fabriquer une arme nucléaire, Riyad couvre ses arrières. La capacité de Tel-Aviv à bloquer cette initiative s’amenuise.
De l’allié au parent pauvre
Tout avait pourtant si bien commencé. Netanyahou avait qualifié Trump de «meilleur ami qu’Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche». Il a obtenu des bombes antibunker, une invitation à la Maison-Blanche et a vécu son heure de gloire. Il a publié sur X que cette alliance est renforcée, et plus forte que jamais.
Comme en amour, une approche trop agressive en politique peut aussi vous valoir d’être ignoré. Netanyahou en a trop voulu, et trop vite. Aujourd’hui, Trump ne répond plus au téléphone. Les appels sonnent dans le vide. Et Israël, autrefois confortablement installé à la table des négociations, ressemble désormais à un ex plein d’amertume, condamné à voir la signature des accords lui échapper.
Et ce que l’État occupant redoute le plus, ce n’est pas seulement l’exclusion, mais ce qui sera signé en son absence, sans pouvoir s’y opposer.
Traduction: Spirit of Free Speech
- Source : The Cradle (Liban)